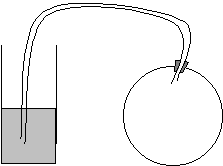
| page précédente | sommaire |
| Les « thermomètres » de l’Antiquité | Les premiers thermomètres | Naissances des différentes échelles thermométriques | Epilogue : échelle absolue |
1. Les « thermomètres » de l’Antiquité
La chaleur dans la science grecque antique
Tout corps chaud ou froid était censé contenir de la chaleur ou du froid.
Pour Aristote, le chaud et le froid constituent,
avec le sec et l’humide, les quatre qualités fondamentales sous l’influence
desquelles la matière première du monde a formé les quatre éléments : l’air,
le feu, la terre et l’eau.
Straton de Lampsaque, célèbre pour avoir introduit l’expérimentation dans le
développement de la physique d’Aristote, fit quelques expériences qui eurent
pour objet l’air et le vide: sous l’influence des idées de Démocrite, il admettait
l’existence du vide entre les plus petites particules de la matière, appelées
les atomes (étymologiquement, les «insécables»), et il expliquait de cette façon
les phénomènes de dilatation ou de contraction que la chaleur ou le froid produisent
dans les corps.
Le thermoscope de Philon de Byzance
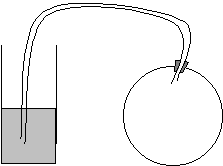 |
Le premier appareil construit fut inventé, vers 250 avant notre ère, par un ingénieur alexandrin, Philon de Byzance . Il comprend un ballon de plomb, vide et muni d’un bouchon étanche; une des branches d’un tube de verre, en forme d’U renversé, traverse le bouchon, tandis que son autre branche descend au fond d’un vase plein d’eau. Lorsque l’appareil est exposé au soleil, l’air qui se dilate dans le ballon de plomb provoque l’émission de bulles dans l’eau du vase. Puis, si l’on place l’appareil à l’ombre, l’air se refroidit dans le ballon, et l’eau du vase monte dans le tube de verre pour s’écouler ensuite dans le ballon. Lors d’un nouvel échauffement, l’air dilaté refoule cette eau dans le vase. Philon décrit cet appareil dans un ouvrage intitulé Pneumatika ; il déduit de son fonctionnement que le feu est étroitement associé à l’air et que même il l’attire. La conclusion révèle la nature de l’explication des phénomènes thermiques propre aux physiciens hellènes. |
Le thermoscope de Héron d’Alexandrie
Un autre appareil thermoscopique fut conçu, vers 100 avant
notre ère, par l’ingénieur Héron d’Alexandrie.
Mais, étant donné la structure
sociale du monde hellénistique, les savants de l’époque ne furent pas incités
à progresser dans la voie de la recherche expérimentale tracée par Straton,
et les ingénieurs qui appliquèrent les inventions de Héron se bornèrent à équiper
les temples en dispositifs permettant de faire croire aux miracles, ou même
se contentèrent de construire pour la classe dirigeante ce qu’on appellera par
la suite des jouets de salon.
L’invention du thermomètre
Des conditions favorables à la reprise du développement de la physique expérimentale
vont apparaître en Europe occidentale à la Renaissance.
Les Pneumatiques de Héron, dont le texte grec, conservé dans quelques
bibliothèques, n’avait intéressé personne pendant près de quinze siècles, trouvèrent
des lecteurs en Italie à la fin du XVIe siècle, après la publication
d’une traduction latine à Urbino, en 1575, et de plusieurs éditions en italien,
dont la première parut à Ferrare en 1589.
|
|
Le médecin Santorio Santorio (1561-1636), professeur
de médecine théorique à Padoue, qui désirait suivre l’évolution de la
fièvre chez ses malades, eut, le premier, l’idée de transformer l’appareil
de Héron d’Alexandrie de manière à pouvoir mesurer le degré de chaleur.
L’instrument qu’il conçut est un thermomètre à air, constitué par une
petite boule de verre, surmontant un tube ouvert, long et étroit, qui
plonge dans un vase plein d’eau. Lorsque le changement de température
de l’air qui surmonte l’eau en fait varier le volume, celle-ci se déplace
dans le tube, en colonne. Le malade introduisait la petite boule de verre
dans sa bouche ou la tenait dans le creux de la main, puis Santorio notait
le déplacement de la colonne d’eau. Ce dernier signala son instrument
dans une publication de 1612 et le décrivit en 1630. Entre-temps, il l’avait
doté d’une graduation décimale qui comprenait deux repères, les premiers
points fixes considérés, obtenus l’un en refroidissant la petite boule
par de la neige, l’autre en la chauffant à la flamme d’une bougie. Comme
on prête volontiers aux riches, plusieurs biographes de Galilée lui ont
gratuitement attribué l’invention de Santorio, de trois ans son aîné |
D’autres thermomètres
Les indications des premiers thermomètres dépendaient
des variations de la pression atmosphérique, dont le physicien italien Evangelista Torricelli
donna, en 1644, une interprétation correcte. Le grand-duc de Toscane, Ferdinand II
de Médicis (1610-1670), que la physique intéressait plus que la politique, entreprit
de perfectionner l’instrument de Santorio, de manière à réduire cette dépendance.
Secondé par un habile émailleur, du nom de Mariani, il eut tout d’abord l’idée
de placer dans un tube plein d’esprit-de-vin des billes de verres creuses,
de densité apparente voisine; étant donné que la température déterminait les
conditions de flottaison des billes, la position de celles-ci indiquait les
variations de la température. Torricelli fit voir de tels tubes en novembre
1646 au voyageur lyonnais Balthazar de Monconys (1611-1665), de passage à Florence.
C’est en 1654 que le grand-duc fit fabriquer le
premier thermomètre véritable, à alcool, constitué par un tube de verre fermé
à une extrémité et terminé à l’autre par un réservoir en forme de boule. Le
thermomètre florentin était d’ordinaire divisé en 50 degrés; certains modèles
l’étaient en 100 ou en 300 degrés; chaque degré était marqué sur le tube
par un point d’émail, blanc pour les dizaines, noir pour les autres. Le thermomètre,
divisé en 50 degrés, ne dépassait pas 40 degrés l’été à Florence;
l’hiver, il y descendait parfois jusqu’à 7; dans la glace fondante, il marquait
13,5 degrés. On ignore les bases de la graduation utilisée par Mariani,
dont l’habileté était telle que tous les thermomètres divisés en 50 degrés
qu’il fabriquait donnaient les mêmes indications.
Le thermomètre de Florence permit aux membres de
l’Accademia del cimento (Académie de l’expérience), fondée en 1657 par le grand-duc,
de faire de nombreuses observations durant les dix années d’existence de cette
célèbre institution. Ils expérimentèrent aussi le mercure comme liquide thermométrique,
mais, trouvant l’esprit-de-vin plus commode en raison de sa dilatabilité plus
élevée, ils le conservèrent.
Le thermomètre de Florence fut assez rapidement
connu à l’étranger, mais par quelques exemplaires seulement. L’astronome Ismaël
Boulliau (1605-1691) l’avait installé rue des Poitevins, dans l’hôtel de Thou.
Un voyageur anglais en rapporta un à Londres en 1661 à son retour d’Italie.
3. Naissances des différentes
échelles thermométriques
Quelques évolutions
Le thermomètre de Florence avait révélé aux physiciens
la faculté de mesurer la température en repérant la variation du volume d’un
fluide emprisonné dans une enceinte de verre. Les premiers thermomètres étaient
surtout destinés à des mesures météorologiques. Le souci d’utiliser un instrument
qui ne fût pas trop encombrant conduisit à prendre pour fluide thermométrique
un liquide se dilatant de manière sensible. Certains conservèrent l’esprit-de-vin,
d’autres adoptèrent le mercure, Newton proposa en 1701 l’huile de lin.
Quelques physiciens utilisèrent un thermomètre à
air. Guillaume Amontons (1663-1705) fit fabriquer un instrument qui lui permit
de constater en 1699 que « l’eau commune bouillante ne peut acquérir un plus
grand degré de chaleur, quelque long temps qu’elle soit sur le feu, et quelque
grand que soit ce feu ».
Les thermomètres à esprit-de-vin ou à mercure construits
après le thermomètre de Florence étaient logés dans une planchette ou dans une
plaque de métal, sur laquelle était portée la graduation en degrés. De très
nombreux types de graduation furent en usage jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.
En 1665, le physicien anglais Robert Hooke (1635-1703)
fit construire un thermomètre à esprit-de-vin, dans lequel le zéro était placé
au point de congélation de l’eau distillée et les degrés correspondaient à des
millièmes du volume initial. La graduation de Hooke ne fut pas suivie par les
constructeurs contemporains, qui préférèrent recourir à deux points fixes.
Le napolitain Sebastiano Bartolo est le premier
à proposer l’utilisation de la neige et de l’eau bouillante.
Le constructeur Joachim d’Alencé, dans un traité
paru à Amsterdam en 1688, proposa deux paires de points fixes, soit le point
de congélation de l’eau et le point de fusion du beurre, soit la température
d’un mélange de glace et de sel et celle d’une cave profonde, dont les mesures
avaient révélé la constance.
D’autres repères furent utilisés. Chaque constructeur
déterminait lui-même la graduation: celle-ci portait à la fois sur le nombre
de divisions entre les deux points fixes considérés ou sur la valeur de la partie
aliquote du volume initial, dans le cas d’un seul point fixe retenu, ainsi que
sur le sens des degrés croissants, qui dans certaines échelles indiquait l’échauffement,
dans d’autres le refroidissement.
Parmi les thermomètres inventés au XVIIIe siècle,
deux étaient appelés à connaître une grande diffusion: le thermomètre Réaumur
et surtout le thermomètre Fahrenheit.
Le thermomètre Fahrenheit
L’astronome danois Ole Roemer (1644-1710) construisit, en 1702, un thermomètre
à esprit-de-vin : il marqua la division 60 dans l’eau bouillante et
la division 8 dans la neige ou la glace pilée, puis les graduations allaient
de 8 à 59. L’hiver à Copenhague, le froid ne descendait jamais au-dessous du
zéro correspondant. Les thermomètres usuels, il les étalonnait à l’aide du précédent,
en les plongeant dans de la neige ou dans de la glace pilée, puis dans de l’eau
chaude ayant une température de 22,5 degrés correspondant à sa graduation
(température du corps humain).
Roemer reçut la visite, en 1708, d’un jeune homme
: Fahrenheit. Il lui montra sa méthode d’étalonnage
des thermomètres usuels, qui en retint l’utilisation systématique du point de
fusion de la glace et de la température du sang comme points fixes. Le point
de fusion de la glace fut dès lors marqué 32 degrés, et la température
normale du corps humain 90 ; estimant peu commode que ce nombre ne fût pas un
multiple du premier, il le remplaça assez tôt par 96 (la température normale
de l’homme est en réalité 98,6°F, soit 37°C). Fahrenheit n’utilisa jamais le
point d’ébullition de l’eau comme point fixe ; en 1724, il indiqua que dans
son échelle définitive ce point se situait à 212 degrés. Après sa mort,
les thermomètres Fahrenheit à mercure furent fidèlement reproduits par Hendrik
Prins, puis par d’autres fabricants, qui normalisèrent les points fixes de l’échelle
à 32 degrés pour la fusion de la glace et à 212 pour l’ébullition de l’eau.
Le thermomètre Fahrenheit à mercure s’était rapidement répandu aux Pays-Bas,
en Angleterre et en Allemagne.
Le thermomètre Réaumur
En France, les thermomètres utilisés au XVIIe siècle
étaient à esprit-de-vin, et durent attendre jusqu’à 1730 pour être bien définis.
Ce fut à cette date que Réaumur communiqua à l’Académie
royale des sciences ses Règles pour construire des Thermomètres dont les
degrés soient comparables, et qui donnent une idée d’un Chaud ou d’un Froid
qui puissent être rapportés à des mesures connues : il sait l’intérêt
qu’offrent des thermomètres aux indications comparables. Mais une erreur d’interprétation
des écrits de Réaumur fit croire vers 1750 qu’il avait voulu fixer la température
d’ébullition de l’eau à 80 degrés.
Les premiers thermomètres construits par Réaumur
avaient des dimensions énormes : boule de trois à quatre pouces (81 à 108 mm)
de diamètre, tube de quatre à cinq pieds (1,30 à 1,62 m) de hauteur et
de trois à quatre lignes (6,8 à 9 mm) de diamètre intérieur. L’abbé
Nollet (1700-1770), assistant de Réaumur, en fabriqua de plus petits, dont la
hauteur n’excédait pas un pied (32,57 cm). Afin de déterminer le point
fixe avec plus de précision, Réaumur avait adopté, vers 1732, le point de fusion
de la glace.
Durant le siècle qui a suivi l’invention
du thermomètre, une soixantaine de graduations différentes avaient vu le jour.
La normalisation n’était pas encore achevée à la fin de l’Ancien Régime
et allait se réaliser en Europe continentale suivant une graduation centésimale.
La division centésimale
Vers le milieu du XVIIIe siècle
deux types de thermomètres à mercure ont reçu une division centésimale entre
le point de fusion de la glace et la température d’ébullition de l’eau.
Le physicien suédois Anders Celsius
fit construire en 1741 un thermomètre à mercure, qui marquait 0 degré au
point d’ébullition et 100 au point de congélation de l’eau et qui fut utilisé
de 1742 à 1750 à l’observatoire d’Upsal. À la même époque, le secrétaire perpétuel
de l’Académie des beaux-arts de Lyon, Jean-Pierre Christin (1683-1755), faisait
construire par l’artisan lyonnais Pierre Casati un thermomètre à mercure à échelle
centésimale ascendante, qu’il présenta le 19 mars 1743 à l’assemblée publique
de cette Académie.
Le thermomètre suédois et le thermomètre de Lyon
n’auraient eu qu’une utilisation restreinte si la Révolution française n’avait
donné au monde moderne le système métrique, et si la Commission des poids et
mesures, créée par la Convention, n’avait décidé en 1794 que « le degré
thermométrique sera la centième partie de la distance entre le terme de la glace
et celui de l’eau bouillante ».
En octobre 1948, à la suite d’une décision de la
IXe Conférence des poids et mesures, le degré centésimal a pris
le nom de degré Celsius, après une nouvelle adaptation des points fixes primaires
d’étalonnage.
4. Epilogue : échelle
absolue
De nos jours, seuls les degrés Celsius sont autorisés .... mais les Anglo-Saxons
continuent d'utiliser le degré Fahrenheit ! Leur notation est q
afin de ne confondre avec t, le temps ou la durée.
Comment faire la transformation entre les deux unités
? Vous parlez anglais ?
Pour que la mesure devienne indépendante de repères
thermométriques tels que la température d'ébullition ou de congélation de l'eau,
W.Thomson inventa la notion de température absolue
issue de la théorie et notée T avec comme unité le Kelvin : K . La théorie
admet qu'à 0 K la matière est totalement figée ( même
les électrons seraient immobiles dans l'atome ) ; les physiciens préfèrent
utiliser cette échelle «absolue», dont les unités sont identiques aux degrés
Celsius, mais dont l’origine est décalée vers le bas de 273,15 unités. Le zéro
de cette échelle représente l’origine absolue des températures. Aucune température
inférieure n’est envisageable, elle-même ne pourra jamais qu’être approchée
de plus en plus, mais jamais atteinte.
La relation de transformation est : T (K) = 273,15
+ q ( °C )